 OEUVRE MEDICALE
OEUVRE MEDICALE
INTRODUCTION
La présence médicale européenne sur les côtes de l’Afrique était ancienne déjà lorsque s’annonça le nouvel âge colonial des années 1880 -1900. Les expéditions portugaises au XVème siècle étaient en effet accompagnées de médecins qui firent durant des siècles de nombreuses observations le long des côtes africaines occidentales. Mais il n’y avait pas de service médical pour les populations.
L’Afrique au XIXème siècle, grosso modo, avait été explorée par le Nord jusqu’aux régions subsahariennes, par le Sud jusqu’au Kalahari, et par l’Est jusqu’aux grands lacs par les arabes et quelques explorateurs. Par l’Ouest, au Nord et au Sud des tropiques par des expéditions coloniales. Restait au centre équatorial « la terra incognita inviolée ». On allait apprendre qu’elle correspondait à l’immense bassin du fleuve Congo.
Il ne faut pas oublier les expéditions qu’organisa l’Association Internationale Africaine (l’A.l.A.) qui, de Belgique, arrivaient à Zanzibar par le canal de Suez, ouvert depuis 1869, afin de tenter d’aborder le Congo à partir d’une base établie à Karema sur la rive orientale du lac Tanganyika.
La première de ces expéditions appelée expédition Cambier, suite au décès à Zanzibar par dysenterie de son chef le Capitaine Crespel, date de 1877. Elle était accompagnée du Docteur Pierre Dutrieux. Il avait été convoqué du Caire où il exerçait depuis cinq ans. Après quelques mois, malade de fièvres, celui-ci dut rentrer en Europe.
La deuxième expédition, de 1881, dirigée par le Capitaine Popelin, avait, parmi ses membres, le Docteur Théodore Vanden Heuvel, que l’on retrouvera au Congo. Ce dernier fut désigné à Tabora comme responsable du campement belge avec son poste médical et des bagages. Il revint en Belgique en 1882. Cette expédition allait renforcer la situation fortifiée de Karema, construite par Cambier sur la rive orientale du lac Tanganyika. Elle avait aussi pour mission d’installer un poste belge à Nyangwe, grand centre de commerce arabe, principalement d’esclaves et d’ivoire sur le Lualaba.
Ce fut un échec.
On ne relate pas la présence de médecin dans les quatre expéditions suivantes.
Il fallut attendre le fabuleux voyage de Morton Stanley pour que fut démontrée la possibilité de pénétrer au cœur de l’Afrique Noire. En neuf cent nonante-neuf jours, de 1874 à 1877, partant de Zanzibar avec sa «colonne», deux Européens, des soldats zanzibarites et des porteurs, mais pas de médecin, il commença par reconnaître tout le pourtour du lac Victoria, puis descendit vers le Tanganyika, se rendit au Lualaba, acheta dix-sept pirogues et arriva par la longue boucle du fleuve Congo jusqu’au pool de Léopoldville, puis à Boma par la route des caravanes et rentra en Europe.
En 1877 Boma est un petit poste commercial où résidaient quelques trafiquants dont des Belges.
Comme on sait, Stanley fut engagé par le Roi Léopold II avec un contrat de cinq ans, de janvier 1879 à la fin de 1884, pour le Comité d’Etudes du Haut-Congo.
Stanley repart et fonde immédiatement la station internationale de Vivi. Ensuite celles de Banane, de Boma, de Matadi, de Manyanga et enfin de Léopoldville. Ces stations sont rapidement dotées d’un médecin et d’un hôpital. Le premier est celui de Boma, construit en 1882 et que dirigea le Docteur J-B. Allart, de 1882 à 1885.
Les premiers médecins arrivés sont bien connus : ce sont les Docteurs Nilis, Leslie, Wolf, Mense et le pharmacien Courtois.
De 1876 à 1885, c’est aussi l’époque des expéditions militaires qui vont combattre les esclavagistes surtout à l’Est et ouvrir le pays. Dès 1872 Livingstone avait constaté ce véritable fléau pour les populations. Plusieurs médecins, tel le Dr Meyers, y ont été affectés et ont joué un rôle important.
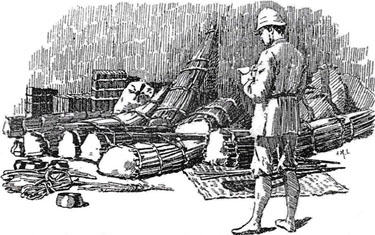
Avant ces expéditions, il avait fallu attendre l’arrivée au Pool de Léopoldville des petits steamers, amenés de la côte en pièces détachées par la «Route des Caravanes». On pouvait dès lors remonter le fleuve et son premier affluent important, la rivière Kasaï, lancer des explorations de pénétration et créer des postes d’occupation.
Enfin fut étudié le parcours et construit entre 1888 et 1898 le chemin de fer reliant Matadi à Léopoldville, ce qui facilita grandement l’acheminement de matériel vers le Haut-Congo et l’exportation des récoltes de produits tropicaux.
En 1876 déjà, le Roi Léopold II, dans le discours qu’il prononça lors de l’inauguration de la Conférence Géographique de Bruxelles, assigna entre autres objectifs à l’Association Internationale Africaine, chargée d’explorer le bassin du Congo, la création de stations hospitalières. C’est dire l’importance que le Roi attachait aux problèmes de santé.
Pour le territoire qui deviendra le Congo, les maladies rencontrées et leur mode de transmission étaient cependant, pour la plupart, très mal connues, si pas inconnues, par les médecins belges qui n’avaient encore aucune expérience de l’Afrique, et les remèdes à l’époque étaient souvent inexistants.
Que l’on pense simplement au paludisme et à la redoutable fièvre bilieuse hémoglobinurique, aux dysenteries, aux verminoses, à la lèpre, au pian et à la terrible maladie du sommeil.
Il n’y avait pas d’antibiotiques à l’époque et l’usage d’un anti-malarien comme la quinine, était exceptionnel.
Les premiers médecins envoyés sur place firent leur apprentissage à partir de cette situation en se familiarisant «sur le tas» avec la pathologie rencontrée.
Ce n’est en outre pas en Belgique seulement que s’opère le recrutement dans la période de début de la colonisation. On peut estimer à environ 40% la proportion d’Européens non Belges qui occupèrent des fonctions diverses, dans le service médical et les différents autres secteurs.
De plus, le territoire de la Colonie était très mal connu et il n’y avait que peu de voies de communication, en dehors des cours d’eau le long desquels se trouvaient la plupart des établissements humains, ou des pistes traversant forêts et savanes. Les déplacements ne se faisaient qu’en pirogue ou à pied et les distances ne se comptaient pas en kilomètres mais en heures de marche ou de «pagayage», ce qui rendait la notion d’urgence toute relative. Il suffit de regarder les cartes de l’époque pour constater les grands espaces blancs qu’elles comportaient.
LE SYSTEME BELGE DE POLITIQUE DE SANTE
Dès les débuts de la colonisation, la politique de santé a eu le souci constant de s’adapter aux contingences locales. Cette adaptation repose sur une haute priorité accordée à la recherche. Cette politique a aussi été guidée par le souci de porter les interventions de la santé jusqu’aux points les plus éloignés pour assurer une surveillance de la population aussi étendue que possible.
Pour ce faire, étant donné la vaste superficie du pays et la faible densité de la population, de 2,5 à 7 habitants au kilomètre carré, l’Etat a eu recours à l’intervention combinée de son propre personnel, et de celui des missions religieuses, des sociétés industrielles ou minières et d’organismes philanthropiques.
Ces caractéristiques découlent d’un souci d’efficacité et de pragmatisme qui permettent de répondre sans tarder à des problèmes locaux.
L’action sanitaire va à la rencontre des populations dans leurs villages, permettant une détection précoce des problèmes et les soins sur le terrain.
A cette fin, sont organisées des équipes mobiles comprenant un médecin ou un agent sanitaire, des aides infirmiers, des microscopistes et des porteurs.
La réglementation en vigueur permettait le rassemblement, sous la responsabilité des chefs locaux, de la population dans les villages où se rendait l’équipe itinérante.
Le nombre de médecins étant insuffisant pour desservir à la fois les hôpitaux, les dispensaires, les laboratoires et les services d’hygiène, assurer la direction des services aux niveaux central et provincial, et d’autres fonctions encore, l’Etat fit appel à la collaboration de médecins des sociétés et missions religieuses mais aussi à des auxiliaires médicaux qui joueront un rôle de vigie :
- d’une part des microscopistes africains formés sur le tas,
- des chefs d’équipes pour les missions mobiles, dont les premiers furent des missionnaires catholiques et protestants, formés à Léopoldville dès 1907.
L’enseignement de ces auxiliaires est officialisé en 1919 par la création du grade d‘Agent Sanitaire, dont la formation se fera par la suite durant six mois de cours à l’Institut de Médecine Tropicale à Anvers.
Les tâches de l’Agent sanitaire sont multiples et caractérisées par l’itinérance. Ses activités principales étant la direction d’une équipe qui procédait au recensement médical, en principe semestriel, de la population, ainsi qu’au dépistage des maladies endémiques ou épidémiques, aux traitements de celles-ci et aux vaccinations.
Si un corps médical relativement peu nombreux a pu, en quelques années, maîtriser la plupart des grandes endémies et étendre dans toutes les régions du pays, un réseau de surveillance sanitaire et de soins primaires, c’est grâce à la collaboration efficace de ces auxiliaires polyvalents qui atteignaient les populations jusque dans les régions les plus reculées.
L’action des équipes itinérantes fut consolidée par la construction, au centre des circonscriptions locales, de dispensaires ruraux. Ceux-ci prennent en traitement les malades découverts par les équipes, aussi bien que ceux qui s’y présentent spontanément pour le traitement d’affections de toute nature entre deux dépistages ou deux recensements médicaux.
Parallèlement à cette action en zones rurales, les chefs-lieux des districts et ensuite ceux des territoires, furent dotés peu à peu de formations médicales plus importantes. En 1920, les services du gouvernement comptaient 34 établissements hospitaliers pour les nationaux, totalisant 3.040 lits. A ces chiffres, il faut ajouter les formations médicales missionnaires et celles des sociétés commerciales et industrielles.
Le médecin colonial
Le jeune médecin pouvait faire carrière de quatre façons, en s’engageant :
- soit à l’Etat (Ministère des Colonies)
- soit dans une mission (catholique ou protestante)
- soit dans une entreprise
- soit en s’installant comme indépendant.
Le médecin qui avait choisi la première option n’apprenait sa destination qu’après son départ, soit lors du deuxième jour de navigation s’il avait choisi la voie maritime, soit en se présentant au bureau du médecin chef à Léopoldville s’il avait choisi la voie aérienne.
Celui qui avait choisi l’une des trois autres options connaissait généralement sa destination avant son départ.
Pour pratiquer au Congo, tous devaient avoir obtenu le diplôme de l’Ecole de médecine Tropicale de Bruxelles ou plus tard à l’Institut de Médecine Tropicale à Anvers, et à leur arrivée faire un stage d’un mois auprès de confrères chevronnés, principalement en chirurgie et au laboratoire.
Le jeune médecin désigné pour un poste dans un territoire encore équipé de façon rudimentaire, comme il en existait encore quelques- uns au début des années 1950 et qui, étant l’apanage des «nouveaux», ne disposait souvent ni de l’eau courante, ni de l’électricité, mais bien de trousses chirurgicales et éventuellement d’un bâti équipé d’un réchaud à pétrole permettant de stériliser le matériel et les alèzes, et ainsi quand même intervenir à l’aise. L’éclairage étant à faire par lampe Coleman en l’absence de groupe électrogène.
Le débutant était donc quand même mieux équipé que les célèbres chirurgiens de l’épopée napoléonienne, et pouvait faire face à la plupart des problèmes qui se présentaient.
Le médecin ayant le privilège d’entreprendre sa carrière «en brousse» c’est-à-dire isolé loin des grands centres, dans la savane ou la profondeur de la forêt tropicale, en contact rapproché des populations locales, pourra se rendre rapidement compte qu’il est plongé dans un autre monde, envers lequel certains ont pu ressentir du respect et un sentiment d’humilité, ou se sont au moins posé des questions philosophiques, par exemple : comment agir pour le mieux dans ce monde où le surnaturel se mêle au naturel.
Soumis aux influences de l’esprit des ancêtres, aux « forces et pulsions vitales », au pouvoir des féticheurs avec leurs fétiches, à la magie des sorciers, la population reconnut cependant les bienfaits que nous pouvions leur apporter et sut les apprécier. Mais cette population adopta et conserva une attitude critique en recourant préférentiellement, selon les cas, au médecin blanc ou à son collègue noir, le «nganga nkissi», ou encore au féticheur ou au sorcier dont les remèdes suscitèrent la pharmacognosie, c’est-à-dire l’étude des médicaments d’origine végétale ou animale chez les médecins et pharmaciens.
En ce qui concerne le personnel du gouvernement, son activité et son comportement faisaient annuellement l’objet d’un «bulletin de signalement» dont la conclusion influait sur sa rémunération et ses promotions en grade.
Cette promotion exigeait en outre pour les médecins après six ans de carrière de se soumettre à un examen B, consistant en un travail personnel sur une pathologie tropicale. Il est remarquable par ailleurs de constater que le premier critère cité sur le bulletin de signalement est «le sens de l’initiative». Cela donne une idée des conditions du travail en brousse, du médecin comme des autres professions, et l’on peut y ajouter la débrouillardise, le pragmatisme et le sens de la communication avec la population et ses chefs, ce qui concernait aussi les agents sanitaires et autres professions ayant recours à l’itinérance.
Il y eut aussi de nombreuses initiatives privées.
Certaines épouses de coloniaux, «des broussardes» n’ont pas hésité à dispenser des soins à la population environnante de leur habitation, aussi bien adultes que nourrissons.
Une initiative privée aux suites plus impressionnantes a été celle de la mise sur pied en 1957, à Léopoldville, d’un Centre de Rééducation pour Handicapés Physiques dans un local de l’YMCA – Young Men’s Christian Association-.
En 1958, eut lieu l’inauguration officielle du Centre par des autorités locales. Cette initiative fut due à deux dames, la première qui en fit la suggestion à Yolande Decraeye et cette dernière qui devint le moteur de l’œuvre projetée, sous le patronage de la ligue belge des paralysés cérébraux. Les deux dames bénévoles purent bien vite compter sur la coopération d’un kinésithérapeute rémunéré par le Centre et d’un infirmier congolais payé par le gouvernement.
En 1962 cette équipe fut renforcée par la collaboration du Dr Hennebert, professeur à Lovanium et le Dr Cardenal de l’OMS à partir de 1964.
Les enfants étaient nombreux, atteints de paralysie cérébrale mais surtout victimes de l’épidémie de poliomyélite qui régnait. Mais nombreux étaient aussi les adultes, surtout victimes de chutes d’arbres lors de la cueillette des fruits.
Le Centre prit rapidement de l’ampleur tout en perfectionnant ses installations.
En 1962 également, cette équipe fut renforcée par l’arrivée, à temps partiel, de Mme Hanot, infirmière avec compétence en électrothérapie.
En 1970, la gestion de ce Centre est reprise par les Frères de la Charité de Gand et cinquante ans après l’Indépendance il se développe encore. A son démarrage, il reçut une aide financière de la part du Lions Club.
A Bukavu un centre analogue reçut l’aide du Rotary Club pour permettre à un médecin de se spécialiser aux Etats-Unis.
C’est le cas aussi du Centre d’Etudes des problèmes Sociaux Indigènes, le CEPSI, né durant la guerre au Katanga. En 1956, l’UMHK lui confie un vaste programme de promotion rurale. Marceline Lonhienne se consacra à la défense de la femme africaine et à la promotion sociale durant cinquante années, dont 19 années après avoir été pensionnée.
L’enseignement médical
Pour son démarrage il a fallu attendre :
- Qu’il y ait suffisamment de médecins disponibles. En 1896 ils étaient 8, en 1899, 25 et en 1924 on en comptait 144.
- Que soient connues les maladies épidémiques et endémiques qui déciment les populations locales. Des missionnaires protestants et catholiques s’efforcent d’y remédier et l’abbé Vanderyst publie en 1913 un recueil de vulgarisation intitulé «Notions élémentaires concernant les maladies tropicales» préfacé par le Dr Rhodain.
- Une scolarisation préalable de divers niveaux et une formation morale adaptée à l’éthique de la profession.
Le but étant de pouvoir former un personnel capable de porter seul des responsabilités, quatre niveaux de formation furent envisagés :
- Le degré inférieur forme des aides-infirmiers et aides-accoucheuses.
- Le degré moyen : des infirmiers, des infirmières accoucheuses et des gardes sanitaires.
- Le degré supérieur forme des assistants médicaux, des infirmières hospitalières, des assistants en pharmacie.
- L’enseignement universitaire qui forme des médecins, des pharmaciens, des dentistes et des biologistes.
La première université, Université de Lovanium, fut ouverte à Kimwenza (Léopoldville) en 1954, suivie de celle d’Elisabethville en 1956. Deux médecins congolais furent diplômés en 1961 à Kimwenza au terme de sept années d’études, diplôme équivalent à celui en vigueur en Belgique.
Retrouvez les témoignages sur ce sujet dans la vidéo ″Oeuvre médicale″
Retour Documents
